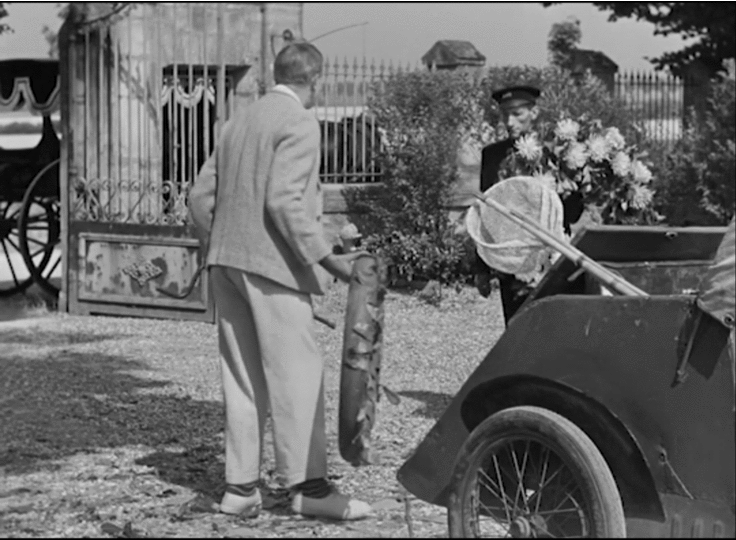Personnages ou spectateurs : à qui profite la démocratie burlesque de Jacques Tati ?
Ce que j’ai essayé, pour ma part, c’est de prouver et faire voir que, dans le fond, tout le monde était amusant. Il n’est pas besoin d’être un comique pour faire un gag1.
I. Le gag émancipé
Au moment de la sortie des Vacances de Monsieur Hulot en 1953, et plus tard à l’occasion de diverses interviews, Jacques Tati présente sa conception du burlesque comme un profond renouvellement du comique traditionnel, « une tentative absolument différente, un autre genre de comique2 » : dans ses films, le déroulement des gags échappe à l’ascendant exclusif du héros, les seconds rôles et les figurants sont autant de relais de l’action comique et le burlesque s’ouvre en conséquence à ce que Tati appelle le « gag naturel », celui que l’on rencontre quotidiennement dans les petites maladresses de la vie courante et qui frappe sans discernement « riches et pauvres, grands et petits, malades et bien portants » – en somme, un gag « démocratique3 ».
Exemple : Monsieur Hulot, au volant d’un tacot pétaradant, tombe en panne aux abords d’un cimetière où se tient un enterrement. Voulant réparer son engin il sort de son coffre divers outils et laisse tomber une chambre à air sur un tapis de feuilles humides : les feuilles se collent au pneu qui se transforme en couronne, laquelle est pieusement acceptée par l’ordonnateur des pompes funèbres.
Commentant cet exemple, Tati se compare à Chaplin pour souligner l’originalité de sa mise en scène : « Charlot, dit-il, aurait collé lui-même les feuilles sur la chambre, transformé la chambre en couronne et elle aurait été acceptée de la même façon par le garçon qui s’occupait du service. » Avec Tati c’est le geste du garçon des pompes funèbres, acceptant le pneu comme une couronne, qui donne son sens au gag et non l’étourderie de Monsieur Hulot qui, lui, « n’invente jamais rien4 » – là où Charlot submerge le monde de sa présence, Hulot s’absente et le gag s’émancipe de son emprise : « le monde est rendu comique par l’absence de comique de Hulot5 ».
Si la comparaison avec Chaplin est éclairante, l’originalité de cette scène est moins manifeste si l’on convoque Buster Keaton ou Harry Langdon qui apparaissent de façon plus évidente comme les initiateurs de la tradition du héros passif ; il est vrai par ailleurs, comme le souligne Barthélémy Amengual, que « personne n’est drôle en soi, puisque nul n’est seul au monde6 ». En réalité, ce n’est pas tellement l’effacement du personnage que l’évanescence des gags qui distingue le burlesque de Jacques Tati : la structure condensée du gag traditionnel qui, sitôt amorcé, appelle une chute, est ici émiettée entre les différentes scènes, certains gags sont tout simplement tronqués, amputés du final attendu, d’autres s’estompent en d’infinis ricochets étalés sur la durée du film d’une manière tout à fait nouvelle – l’exemple, commode, que le réalisateur choisit pour faire l’exégèse de son œuvre est à cet égard peu représentatif du film, les causes et les effets étant souvent plus disjoints que dans cette scène. C’est la singularité radicale du cinéma de Jacques Tati que de prendre constamment le risque de ne pas faire rire, en préférant la poésie des harmonies secrètes à la lisibilité du gag. « Il est bien clair, écrit Michel Chion, que si Tati refuse quelque chose dans le jeu habituel du comique c’est le matraquage. Chez lui, un gag doit se débrouiller seul7. » On admettra que le gag ne saurait s’émanciper des structures qui corsètent son développement ordinaire sans que ne soit contenu, d’une manière ou d’une autre, l’empire qu’exerce le héros sur la rigolade, mais la nouveauté n’est pas ici dans l’attitude du personnage vis-à-vis du gag, comme le pense Tati, mais plutôt dans celle du cinéaste vis-à-vis du rire : sans doute en partie délivré de l’impératif commercial qui dirigeait l’industrie où exerçaient ses illustres prédécesseurs américains, pour qui le rire de la salle avait parfois le dernier mot de la mise en scène (lors des fameuses previews), Jacques Tati reste l’unique exemple d’un cinéaste comique dont il semble que l’ambition première n’ait pas été de faire rire – « il ne cherche pas à imposer le rire mais se contente de le proposer8 ». Une fois affranchi de l’autorité du rire, le gag avait besoin d’un écrin assorti aux richesses de ses multiples éclats ; après avoir tourné Mon Oncle en 1958, Tati devait parfaire sa création dans Playtime (1967), en même temps qu’il préciserait le sens de son projet de démocratisation du comique.
II. Le plan démocratique
Quatorze ans après Les Vacances de Monsieur Hulot, le style du cinéaste s’est indéniablement radicalisé : dans Playtime, le personnage principal disparaît presque complètement dans la foule des figurants où l’on aperçoit même de faux Hulot – des doubles dont Tati parsème son film pour mieux marquer la déchéance du héros comique traditionnel et ainsi attirer l’attention du spectateur « sur toutes les autres figures et sur tout le décor9 » – ; la trame narrative qui guidait encore de façon lointaine Les Vacances et Mon Oncle a presque totalement disparu, Playtime déploie une série de gags qui se répondent selon des variations et des correspondances inextricables, éclatées entre les différentes séquences du film et presque impossible à démêler lors d’un premier visionnage ; enfin, Tati généralise l’usage du plan d’ensemble, c’est la véritable innovation du film : l’échelle adoptée permet de chorégraphier simultanément plusieurs gags au sein d’un même plan ; non seulement le héros burlesque n’a plus le monopole du gag mais il perd en plus sa prérogative de « personnage de premier plan10 » – là encore s’exprime le souci du cinéaste : démocratiser.
Il est préférable de lire cet article en plein écran pour profiter des animations.
Exemple : Vue d’ensemble sur un vaste hall – le décor est impersonnel, composé en nuance de gris et de bleus glacés, c’est peut-être un couloir d’hôpital, mais ce serait tout aussi bien un aéroport ou le siège d’une grande entreprise. Un couple est assis au premier plan sur une banquette située en bas à gauche du cadre, l’épouse, visiblement inquiète, murmure quelques recommandations inintelligibles à son mari. Leur discussion est entrecoupée par les allées et venues de différents personnages à l’arrière-plan dont l’observation attentive fournit au spectateur les premiers indices sur le lieu où se passe l’action : un homme en tablier conduit un chariot de service où sont entreposés assiettes et couverts, une sage femme porte un bébé enveloppé dans un lange tandis qu’une femme vêtue de beige pousse un parent âgé dans un fauteuil roulant. Serions-nous dans un hôpital ? Le style vestimentaire de l’homme qui sort des toilettes au début du plan suivant, chaussé de pantoufles noires, une serviette enroulée autour de la tête, semble confirmer provisoirement cette intuition mais la suite de la séquence révèle toute autre chose…
À supposer qu’il existe un spectateur capable de suivre simultanément chacun des fils de cette trame arborescente, Tati nous offre en effet la possibilité, dans les plans qui suivent, de réévaluer point par point notre analyse en regardant la scène depuis son contrechamp – nous n’étions pas dans un couloir d’hôpital mais dans le hall d’un aéroport international : lorsque la sage femme nous apparaît de face, nous comprenons que ce n’était pas un bébé qu’elle portait dans ses bras mais une pile de serviettes dont on la voit approvisionner le distributeur des toilettes, elle n’est donc pas sage femme mais agente d’entretien, un deuxième visionnage permettra de distinguer le landau gris, peu visible, du couple au premier plan, d’où s’élèvent les geignements du bébé ; de même, la femme en beige ne poussait pas un fauteuil roulant mais un simple porte-bagages sur lequel étaient empilées plusieurs valises recouvertes d’un châle ; l’homme au chariot de service ne transportait pas le repas des malades mais allait approvisionner le bar de l’aéroport, quant à celui qui sortait des lavabos en chaussons, nous l’apercevons plus tard rejoindre une femme vêtue à l’Orientale : son habillement n’avait donc rien d’un négligé de toilette, la serviette qu’il arborait sur le crâne était en réalité un turban.
Pour Jacques Tati, « l’imagination vient au secours de l’observation11 », le contexte lacunaire (sommes-nous dans un hôpital ou un aéroport ?) provoque une situation éminemment suggestive dans laquelle chaque élément de l’image recèle un gag en puissance ; dans la scène qui nous occupe, le sens de certaines actions est volontairement trouble de sorte que l’hypothèse de l’hôpital puisse se maintenir suffisamment longtemps pour donner à relire les premières minutes du film à la lumière des plans suivants, le gag apparaît dans la comparaison de ces deux lectures possibles de la scène. Nous ne savons pas, par exemple, si l’inquiétude de la femme au premier plan concerne un départ en voyage ou l’hospitalisation imminente de son mari, de même, l’officier qui fait les cent pas dans le couloir s’impatiente-t-il du retard d’un collègue qui compromet son départ en avion ou se fait-il du mauvais sang parce que sa femme s’apprête à donner naissance dans l’une des chambres adjacentes où disparaît celle que nous prenons au début pour une sage femme ? qui font leur entrée à la suite du monsieur en chaussons sont-ils de simples passants qui se croisent par hasard dans le hall d’un aéroport, ou se trouvent-ils ici réunis à l’occasion d’un décès ?
Avant que ne soit révélée la véritable nature du lieu où se déroule la scène, Tati utilise l’incertitude du spectateur pour accroître son acuité à ces détails et ainsi l’habituer à suivre l’action au sein du plan d’ensemble qui demeurera l’échelle réglementaire pour tout le reste du film. Cette circulation du sens est donc avant tout une circulation du regard que Tati favorise par de multiples procédés de stimulation attentionnelle : le couple du premier plan, se tournant pour regarder les passants et commentant leur défilé à voix basse, aiguise la vigilance du spectateur aux événements de l’arrière-plan ; l’étrangeté de ces silhouettes immobiles tout au fond du cadre participe elle aussi d’une vision intranquille de l’image ; l’usage de touches de couleur vive détonne sur le fond gris uniforme et agit comme une véritable signalétique (la balayette rouge de l’agent d’entretien qui cherche en vain quelque poussière dans cet espace immaculé), enfin, la désynchronisation du son et de l’image ou les effets d’amplification sonore qui font entendre telle action se déroulant au fond du décor aussi puissamment que ce qui se passe au premier plan, force le spectateur à une postsynchronisation mentale (quelle est donc la source du son que j’entends ?) et ainsi à pénétrer plus avant dans l’image.
Si cette mise en scène, par l’effort d’attention qu’elle exige, met en péril la lisibilité des gags et donc le rire lui-même, elle offre en revanche au spectateur « une liberté nouvelle : celle de pouvoir goûter ou manquer l’effet, qui n’est jamais assené12 ». L’usage simultané des différents procédés de sollicitation attentionnelle, appliqués de façon concomitante à plusieurs personnages répartis dans le plan, éteint le potentiel « autoritaire » de la mise en scène : Tati ne dirige pas le regard du spectateur sur le mode d’une circulation linéaire, il le disperse, en lui offrant divers points de focalisation13 – ce dernier est libre de choisir la trame qu’il veut suivre, l’action qu’il veut voir, le personnage qu’il veut adopter comme héros temporaire, enfin, ce à quoi il veut rire.
Si le plan d’ensemble, qui rend possible la coïncidence des gags, est véritablement un plan « démocratique », ce n’est peut-être pas à la manière dont l’entend Tati ; certes, grâce à lui, « le droit de faire rire est désormais reconnu à chacun sur l’écran (quelle que soit sa place dans le film et sa fonction sociale)14 », mais on pourrait néanmoins objecter que cet égalitarisme a quelque chose de factice dans la mesure où il ne se traduit pas par l’entrée, brusque et soudaine, d’une quelconque réalité sociale au sein de l’univers de Tati : le monde de Playtime est entièrement artificiel, les figures qui s’y déplacent sont des archétypes et si elles disent quelque chose de notre réalité c’est par la vertu de la caricature plus que par leur authenticité – loin de faire disparaître son héros, Tati a créé un monde à son image dans lequel chaque situation, chaque geste, chaque recoin de décors appellent l’« hulotisme », la maladresse et le gag ; il le dit lui-même, sans relever le paradoxe, lorsqu’il affirme vouloir « supprimer le vedettariat du personnage comique principal » et offrir « la possibilité pour chacun d’avoir sa demi-heure d’hulotisme15 », prodigalité qui ne tolère d’altérité que conformée à une identité préconçue.
On pourra juger que Jacques Tati se fait là une idée insuffisamment ambitieuse de la démocratie, mais la sentence serait injuste si on ne disait qu’il est aussi de tous les cinéastes celui qui s’est fait la plus haute opinion de son spectateur, sans quoi il n’eût pas tant demandé de son intelligence et de son attention. La structure de Playtime est « aussi décevante qu’elle est riche, écrit Jean-André Fieschi, (décevante à la mesure même de son incroyable richesse, laquelle ne va pas sans quelque obscure frustration) », il en découle « une exigence tout à fait nouvelle vis-à-vis d’un spectateur que le cinéma, d’ordinaire, essaye plutôt de combler par des moyens plus simples et plus éprouvés16 », cette exigence est une liberté acquise (le droit de regarder où l’on veut et de rire quand on le souhaite) certes au détriment de la fraternité du rire (tous en chœur – en cela le film est « décevant ») mais incontestablement pour le profit de la diversité et de la « richesse » des expériences possibles face à l’œuvre. En ce sens, le plan d’ensemble ne permet pas tant, comme le souhaitait Tati, une démocratisation du gag (l’héroïsation de l’homme ordinaire), qu’il instruit une démocratisation du rire : ce ne sont pas les personnages mais les spectateurs qui sont ici concernés et l’agora démocratique de Jacques Tati ne se tient pas dans le hall de l’aéroport mais bien dans la salle de cinéma.